Portraits d’acteurs sur la conférence AFRAVIH 2018 mercredi 4 avril 2018 : François Dabis et Florence Huber.
Interview François Dabis
François Dabis : COREVIH Nouvelle Aquitaine mercredi 04 ouverture de la conférence
Le Pr Dabis est un expert du VIH reconnu au plan international pour ses nombreux travaux sur l’épidémiologie et les défis de santé publique posés par cette infection virale. Il s’est ainsi attaché, tout au long de son parcours d’enseignant-chercheur, à évaluer des stratégies tant dans la prévention de la transmission du VIH que dans la prise en charge des patients. Le Pr François Dabis est Directeur de l’ANRS ainsi que président du COREVIH et de l’IREPS Nouvelle Aquitaine.
Pour les lecteurs qui ne vous connaîtrait pas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
François DABIS : je suis médecin épidémiologiste. Je suis professeur santé publique ; ici à l’université de Bordeaux. Je suis président du COREVIH Nouvelle Aquitaine et depuis un an également Directeur de l’agence nationale de recherche sida hépatite à l’ANRS.
Pour vous quelles sont les trois dates clés de la lutte contre le sida ?
 Trois dates clés… uniquement trois. Certainement 1983, l’identification et la publication des virus. L’interaction entre association et recherche non pas parce que c’est une équipe française qui l’a fait mais sans l’identification de la cause, on n’aurait certainement pas progressé assez vite dans la première phase de l’épidémie. Même si les deux années qui ont précédées, on a pratiquement tout compris de l’épidémie et de la transmission de ce virus ; alors qu’on en avait pas la cause mais si on n’avait pas identifié la cause c’est sûr que ça aurait été absolument impossible. Certainement le deuxième moment, c’est l’émergence des traitements dans le monde ; c’est-à-dire le passage du traitement réservé aux pays industrialisés aux traitements dans le monde entier. Soit en 2002, la conférence de Barcelone. En effet, c’était un peu la fin d’un cycle : Jacques CHIRAC, en 1999 va annoncer que les traitements étaient aux nord et les malades au sud ; puis, en 2000, Nelson MANDELA a dit à Durban que c’était inacceptable. En 2002, Nelson MANDELA monte à la tribune avec Bill CLINTON (qui n’était plus président à l’époque) pour dire qu’il fallait passer à l’acte. Ceci a permis, à partir de là, la bascule dans l’air des traitements dans le monde entier. Peut-être que la troisième date que je retiendrais, c’est probablement 2012-2013 ; à savoir la démonstration absolue que le traitement c’est la prévention. Pour le dire autrement, l’essai HPTN 052 qui démontrent définitivement qu’on peut réduire 96 % de la transmission par le traitement. C’est 3 dates prises parmi d’autres…
Trois dates clés… uniquement trois. Certainement 1983, l’identification et la publication des virus. L’interaction entre association et recherche non pas parce que c’est une équipe française qui l’a fait mais sans l’identification de la cause, on n’aurait certainement pas progressé assez vite dans la première phase de l’épidémie. Même si les deux années qui ont précédées, on a pratiquement tout compris de l’épidémie et de la transmission de ce virus ; alors qu’on en avait pas la cause mais si on n’avait pas identifié la cause c’est sûr que ça aurait été absolument impossible. Certainement le deuxième moment, c’est l’émergence des traitements dans le monde ; c’est-à-dire le passage du traitement réservé aux pays industrialisés aux traitements dans le monde entier. Soit en 2002, la conférence de Barcelone. En effet, c’était un peu la fin d’un cycle : Jacques CHIRAC, en 1999 va annoncer que les traitements étaient aux nord et les malades au sud ; puis, en 2000, Nelson MANDELA a dit à Durban que c’était inacceptable. En 2002, Nelson MANDELA monte à la tribune avec Bill CLINTON (qui n’était plus président à l’époque) pour dire qu’il fallait passer à l’acte. Ceci a permis, à partir de là, la bascule dans l’air des traitements dans le monde entier. Peut-être que la troisième date que je retiendrais, c’est probablement 2012-2013 ; à savoir la démonstration absolue que le traitement c’est la prévention. Pour le dire autrement, l’essai HPTN 052 qui démontrent définitivement qu’on peut réduire 96 % de la transmission par le traitement. C’est 3 dates prises parmi d’autres…
Par rapport à ces dates, quel impact ça a eu sur l’implication des associations des comités au sein de la lutte ?
Je ne pense pas que la première date cité, 1983, ai eu beaucoup d’impact sur le mouvement associatif ni sur la lutte communautaire. De toute façon, les associations étaient déjà à l’époque en train de s’organiser et elles avaient tellement de choses à gérer qu’il y a eu peu d’interactions avec la science (même si on a vu si vous regardez 120 battements par minutes que très rapidement la science et le milieu communautaire se sont pratiquement reliés). Il est clair que 2000-2003, avec l’émergence des traitements dans le monde, ça a été décisif. Il faut se rappeler Treatment action campagn en Afrique du Sud et un militant faisant la grève des traitements en disant : « si moi j’ai la chance d’être traité et qu’on ne peut pas traiter les autres et bien je préfère arrêter de prendre les traitements et mourir comme les autres ». C’était, quand même, des moments incroyablement forts. Je trouve que la lutte rassemble à la fois la science et le milieu associatif pour un plaidoyer. Sur la dernière période, concernant le traitement comme moyen de prévention, les associations ont rejoint le mouvement et ont participés à la mobilisation pour le traitement universel. Mais s’il n’y avait pas eu les avancées scientifiques aussi importantes, je pense que le plaidoyer n’aurait pas fonctionné. Ici, c’est un peu l’inverse les associations ont rejoints un mouvement que la science avait vraiment ouvert.
Ceci nous amène à la place des associations dans la recherche car avec l’enquête Parcours et Ipergay notamment on a vu leur capacité à pouvoir intégrer la recherche.
On voit bien que l’interaction entre association et recherche s’est passée en trois phases.
La première phase, c’est celle qui est parfaitement décrite dans 120 battements par minute c’est-à-dire où les associations avaient à défendre le droit des malades et la nécessité absolue de les associer aux étapes de la recherche. C’était un droit qu’il fallait obtenir. Deuxième étape qui a duré longtemps, a été la co-construction de beaucoup de projets de recherche avec le milieu associatif et pour exemple le Trt 5 qui a été un outil quasi parfait. La troisième phase, beaucoup plus récente, a été, à mon avis, le démarrage en France d’Ipergay. Je ne suis pas sûr que beaucoup d’autres pays puissent dire qu’ils l’ont fait. Ce n’est plus la co-construction mais l’animation et la responsabilité directe des associations pour piloter de la recherche et ça c’est une nouvelle forme de leadership. A l’ANRS, on le stimule, ce n’est pas évident. A part Parcours, on n’en a pas 250 exemples. Cependant, on sait qu’aujourd’hui en France, nous avons la capacité d’avoir des associations qui peuvent être des leaders aussi bien dans la lutte que dans la recherche.
Pour finir, dans le Sud, à propos des recherches, est-ce qu’il y a des recherches notamment sur la PrEP qui engageraient justement des communautés ?
Le démarrage s’est fait presqu’en parallèle ; c’est-à-dire que s’il n’y avait pas eu les associations au sud, les programmes de recherches n’auraient pas pu s’exécuter aussi vite. Les associations ont répondu présents et grâce à cette synergie, nous avons pu faire pression sur les autorités pour mener des recherches et pour que des comités d’éthiques se développent aussi. Ceci afin de se consolider et travailler dans de bonnes conditions. J’estime que les associations du sud ont fait le même job d’une manière différente, un militantisme différent. Ils n’ont peut-être pas atteint le stade de responsabilité d’être les premiers responsables de la recherche mais j’ai bonne espoir sur des sujets comme la PrEP. Quelques excellentes associations, dans les pays francophones sont en capacité de le faire.
Allons-nous avoir de la coopération internationale au sein des COREVIH ? Est-ce que les COREVIH doivent faire de la coopération internationale ?
Aujourd’hui, il n’y a plus Esther ni tous ses mécanismes. Cela ne fait pas partie des textes réglementaires des COREVIH, ni de l’instruction que le Ministère va donner aux ARS. Cela pourrait être un vrai sujet de débat entre administrateur et coordonnateur de COREVIH. Il faudrait trouver d’autres formes de collaborations. Je ne pourrais pas répondre aujourd’hui s’il faut que les COREVIH s’engage sur l’international.
Interview Florence Huber
Madame Florence HUBER est médecin spécialisé en Dermatologie et Vénérologie. Elle consulte au Centre Hospitalier Andrée Rosemon à Cayenne en Guyane.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
Je suis Florence HUBER
Pouvez-vous nous décrire la ou les structures où vous intervenez ?
 J’ai plusieurs casquettes, une hospitalière, je suis médecin à l’hôpital de jour adultes de Cayenne, je suis également en charge des personnes infectées par le VIH au centre pénitenciers, j’ai des activités associatives, je suis présidente du réseau ville hôpital qui s’appelle le réseau kikiwi et enfin plus récemment depuis fin 2013, je coordonne les CeGIDD pour la Croix Rouge comprenant également un centre de vaccination et lutte antituberculeuse pour les centres de prévention santé de la Croix Rouge de la Guyane donc sur tout le littoral guyanais c’est-à-dire Cayenne, Saint Laurent.
J’ai plusieurs casquettes, une hospitalière, je suis médecin à l’hôpital de jour adultes de Cayenne, je suis également en charge des personnes infectées par le VIH au centre pénitenciers, j’ai des activités associatives, je suis présidente du réseau ville hôpital qui s’appelle le réseau kikiwi et enfin plus récemment depuis fin 2013, je coordonne les CeGIDD pour la Croix Rouge comprenant également un centre de vaccination et lutte antituberculeuse pour les centres de prévention santé de la Croix Rouge de la Guyane donc sur tout le littoral guyanais c’est-à-dire Cayenne, Saint Laurent.
Quels sont pour vous 2 ou 3 dates clès de la lutte contre le Sida ?
La première date est 1981, c’est là où tout a commencé, la découverte du virus le début d’une grosse galère et aussi d’une belle histoire. Fin 1995, début 1996 avec les trithérapies là ça a été la révolution, des patients qui ressuscitaient des morts c’était quand même assez fabuleux et puissant. Troisième période je dirais que c’est aujourd’hui, on est à un tournant où finalement si on prend l’hypothèse pessimiste on risque de stagner et de plonger, de se contenter d’une certaine médiocrité, finalement les personnes les plus vulnérables, les minorités, vont rester lourdement affectées et les autres vont s’en sortir et l’autre hypothèse plus optimiste, c’est qu’on arrive à garder cette motivation, cette mobilisation qui est phénoménal en terme de santé internationale, c’est quand même un cas d’école ce qui s’est passé dans le VIH.
Concernant votre présentation quels sont les moyens que vous avez pu mettre en place en Guyane pour garder dans le soin les sortants de prison tout en étant confrontés aux sorties sèches ?
C’est une question difficile on ne peut pas dire qu’on est optimum, on essaye de s’améliorer c’est une problématique compliquée le premier enjeu c’est la préparation de la sortie comme je l’ai montré dans mon exposé. J’ai essayé de le démontrer avec un vrai travail de collaboration pluridisciplinaire sur l’organisation des sorties. Pour ça il faut pister les dates de sorties, ce qui n’est pas une mince affaire notamment quand on a des prévenus qui sont libérés à l’issue d’un procès, ça on ne maîtrise pas forcément les choses. Il faut pister les dates de sorties travailler main dans la main avec le SPIP ce n’est pas évident dans tous les centres pénitenciers mais en Guyane je dois dire qu’on y arrive quand même un peu. A chaque vacation je passe un coup de fil au SPIP. Il faut essayer de créer, de concevoir des projets avec des patients, avec le SPIP, avec les travailleurs sociaux (même s’ils ne sont pas très nombreux) et enfin après ce travail d’organisation de ces sorties la problématique de l’hébergement crucial puisqu’on a environ un tiers des sortants qui sont sans abri ou en habitat informel, un squat ; ça c’est un gros défi et pour avoir un hébergement il faut un accès au droit, ou en tout cas une perspective d’un accès aux droits, ce qui est le plus gros défi d’entre tous donc on travaille avec des partenaires tels que le CDAD la Commission Départementale d’Accès aux Droits, le SPIP bien sûr, mais ils ont très peu de temps à nous accorder sur ces points là on n’a pas de travailleurs sociaux dédiés donc gros soucis. En fait, pour faire clair, on est très souvent dans l’impasse. J’ai le sentiment très souvent de mentir à mes patients. La problématique post carcérale, la problématique VIH en milieu carcérale est une problématique de réinsertion essentiellement ou même d’insertion car pour certains ils n’ont jamais été insérés donc on peut parler d’insertion. Quand on voit que dans des pays d’Amérique du Nord on a deux fois plus de conseillers d’insertion pour le même nombre de détenus on a compris qu’on mène un combat qui pour certains sont perdus d’avance et ce qui est très désagréable c’est d’avoir le sentiment de mentir au patient en leur disant « voilà on va demander une carte de séjour pour soins ou on va essayer d’avoir un hébergement » alors que dans les faits c’est bien souvent impossible et ça c’est très douloureux, très usant. Les patients sont plutôt de bonnes compositions mais en tout cas moi ça me pose un réel problème de cas de conscience. J’ai l’impression en tout cas en Guyane que je suis arrivée à peu près au bout de ce que je pouvais faire en termes de biomédicale et qu’après le reste joue plus sur des combats politiques sur les plaidoyers, de lobbyings en sachant que la conjoncture actuelle est pas très favorable. En Guyane on a eu des mouvements sociaux assez intenses avec des bons élans xénophobes qui ont refaits surface avec des propos sécuritaires qui étaient quand même très dure envers les détenus donc on n’a pas de bons retours quand on propose de donner plus de droits et de favoriser l’insertion des détenus, ce ne sont pas des sujets d’actualité en Guyane actuellement. Je pense que sur l’ensemble du territoire français également ce ne sont pas des sujets très porteurs malheureusement.
Quels sont vos outils de dépistage rapides VIH ou autre en prison ?
On n’utilise pas beaucoup de TROD enfin quasiment pas puisqu’on a des outils sérologiques, on combine le dépistage syphilis, hépatite B, hépatite C, VIH avec finalement des rendus de résultats en une semaine environ. Après dans notre étude CAP VIH faite en 2014 on avait une proposition conséquente de patients disant ne pas avoir reçus de résultats sérologiques. Grâce aux résultats de notre étude on a pu réussir à corriger le tir, on s’est quand même amélioré, les médecins de l’UCSA qui sont des médecins généralistes très engagés reconvoquent systématiquement les personnes qui ont été testées pour remettre les résultats. À priori là on est plutôt pas mal car c’est exceptionnel que les détenus refusent. Pour toutes ces raisons on a pas forcément eu l’utilité d’utiliser des TROD, même si la question reste posée, mais en tout cas dans l’ordre de priorité ce n’est pas paru en numéro un.
Est-ce que les 21 cohortes du projet MARIC arrivent aux mêmes conclusions ?
Le projet MARIC est un projet international de grande ampleur, on inclut plus d’un million de sortants de prison sur pas mal de pays, piloté depuis l’Australie. Il faut savoir que le projet MARIC s’intéresse aux sortants de prisons tout venants pas forcément infectés par le VIH donc je pense que ça les intéresse d’avoir une cohorte de patients infectés par le VIH parce que ça permet d’avoir des analyses beaucoup plus spécifiques. Sur plus d’un million de sortants nous nos 147 patients n’ont pas forcément un poids très conséquent dans les analyses néanmoins ça me flatte beaucoup qu’ils nous aient proposé de participer au projet. Il y a une problématique de surmortalité carcérale qui dépasse la question du VIH. On a une forte mortalité dans les jours ; voire les mois qui suivent une incarcération indépendamment du VIH. Quand en plus on est infecté par le VIH on cumule la vulnérabilité socio-économique des anciens détenus plus la vulnérabilité biomédicale des personnes infectées par le VIH. Donc on cumule les deux types de vulnérabilités et ça fait un cocktail explosif en termes de mortalité.
En revanche, je ne peux pas vous répondre, sur les résultats qui sont différents d’un pays à un autre dans ce projet MARIC car il y a très peu d’étude déjà publiée. Les anciens détenus meurent beaucoup de morts violentes, d’accident de la route. Ils ont des pratiques à risque dans tous les domaines ; sans parler des overdoses pour les toxicomanes ni des homicides. Donc on a beaucoup de raison de mourir quand on sort de prison en plus du VIH.
En savoir plus….
Santé en milieu carcéral
AFRAVIH 2018 | Amphithéâtre B
mercredi 04 avril 2018 | 13:50 – 14:10
Type: Symposiums et espaces agora
Présentation :
14:00 – 14:10 Pronostic et suivi post-carcéral des PVVIH
Orateur(s): Florence HUBER (Guyane Française)
Présentation le 11 septembre 2015 plénière COREVIH de la thèse d’Alice Merceron : pronostic et suivi médical des patients détenus infectés par le VIH sortis de prison
La Guyane est le département français où la prévalence du VIH est la plus élevée. Comme décrit ailleurs, l’incarcération y a souvent un impact positif sur le diagnostic et sur les paramètres biologiques des personnes vivant avec le VIH (pvVIH). Dans l’unique centre pénitentiaire de Guyane 29,9% des détenus étaient sous traitement ARV à l’entrée en détention, contre 50,3% à la sortie. A l’inverse, 55,8% (n=147) des anciens détenus infectés par le VIH étaient en rupture de suivi un an après leur libération (Merceron, 2015, Huber 2017). Cette communication porte sur les premiers résultats de la recherche opérationnelle Kaïros.
Méthode: Le projet est mené par une équipe interdisciplinaire et interdépendante (sociologue, SPIP, médecin). Objectifs du projet Kairos ▪ Identifier les facteurs favorisant/entravant le suivi post-carcéral des pvVIH. ▪ Faciliter l’orientation post-carcérale des détenus. ▪ Participer à l’insertion socio-sanitaire des détenus, en traitant des enjeux de la RDR ▪ Faciliter le travail en réseau et les collaborations interdisciplinaires autour des malades chroniques après un épisode carcéral. Nous avons interrogé un public diversifié : détenus/ex-détenus vivant avec le VIH, détenus prochainement libérés, professionnels impliqués dans l’insertion socio-sanitaire des détenus. Les analyses préliminaires montrent d’ores et déjà trois résultats importants ➢ Les structures ressources sont méconnues d’un public à risque et en augmentation. Les détenus cumulent des vulnérabilités socio-économiques particulièrement péjoratives (absence d’activité salariée, pas de domicile fixe, séjour irrégulier, addiction aux drogues, etc.), et ils méconnaissent, voire ignorent les actions menées par les structures « ressources » présentes en détention et hors les murs. ➢ Le genre pourrait déterminer l’observance thérapeutique. L’analyse des premiers entretiens suggère que les hommes avaient peu de connaissances sur le VIH avant leur diagnostic, et étaient plus enclins à interrompre le TARV à la sortie d’incarcération. Cela corrobore les résultats d’une étude CAP réalisée en 2015, où les scores de connaissance des femmes étaient significativement supérieurs aux hommes, parmi les détenus de Guyane. En outre, les femmes rencontrées déclaraient effectuer des dépistages réguliers, contrairement aux hommes. ➢ A l’encontre des idées reçues… Pour la plupart des intervenants du champs sanitaire et social interrogés, la situation administrative, économique, et l’absence de domiciliation seraient les trois facteurs principaux qui entraveraient le suivi post-carcéral. Or, les premiers résultats de l’analyse des regards croisés de Kaïros suggèrent que la stabilité du réseau familial et amoureux pourrait être un facteur déterminant pour le suivi post-carcéral. Conclusion et perspectives Alors que le contrôle de la charge virale est une condition essentielle pour stopper la transmission du VIH, les ruptures de suivi post carcérales posent des problèmes sanitaires sur le territoire guyanais, où on estime qu’environ 5% des pvVIH sont sortis d’incarcération entre 2007 et 2013. Malgré les actions menées par les acteurs associatifs, les pvVIH ayant connu un épisode carcéral semblent éloignées des structures d’accompagnement. Le ciblage et les stratégies d’intervention devraient sans doute être réexaminés. Les liens affectifs préexistants pourraient être des déterminants essentiels pour maintenir le suivi au delà de la détention. Ces résultats préliminaires méritent néanmoins d’être conforté par les analyses ultérieures. Un contrat d’initiation de l’ANRS a permis d’amorcer le projet Kaïros en 2015. Ce projet a ensuite obtenu des financements de la MILDECA national et de l’ARS de Guyane.

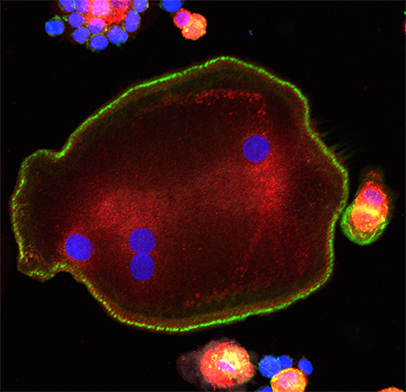
 On développe des axes de plaidoyers communs sur lesquels doivent s’entendre tous les organismes membres. Je travaille pour 5 services juridiques secteur droit et donc je suis un peu l’avocate de référence pour chacun des organismes communautaires dont le quel je siège.
On développe des axes de plaidoyers communs sur lesquels doivent s’entendre tous les organismes membres. Je travaille pour 5 services juridiques secteur droit et donc je suis un peu l’avocate de référence pour chacun des organismes communautaires dont le quel je siège.  et à la société civile qu’on a pu mettre en avant les enjeux et les défis qui sont liés à l’accès aux médicaments. Avant certaines personnes n’avaient aucune information au sujet de leur statut, au sujet du traitement qu’il devait prendre et tout ce qui est en rapport avec le virus du sida.
et à la société civile qu’on a pu mettre en avant les enjeux et les défis qui sont liés à l’accès aux médicaments. Avant certaines personnes n’avaient aucune information au sujet de leur statut, au sujet du traitement qu’il devait prendre et tout ce qui est en rapport avec le virus du sida.  population très ciblée population HSH et on rentre dans un rapport un peu différentiel par rapport aux HSH parisiens avec lesquels j’avais travaillé auparavant. Sur notre territoire ce sont des HSH qui sont moins identitaires, qui ont plus souvent jamais eu recours à la sérologie VIH, qui fréquentent moins de lieux de convivialité gay, parce qu’en Seine-Saint-Denis n’y en a peu ou pas. Ils ont une connaissance un peu différée dans le temps des stratégies de prévention de la PrEP, une moins bonne connaissance de façon générale sur la santé sexuelle, les IST bactériennes. La deuxième population qu’on voit beaucoup, en suivi de VIH, sont les personnes originaires d’Afrique Subsaharienne qui constituent l’essentielle de notre file active. Ces populations bénéficient peu ou pas du tout de la PrEP. Alors on essaye de leur faire bénéficier de tout ce qui est possible comme stratégie de prévention. Je pense que, sur ces populations-là, le Test and Treat ; à savoir le dépistage, beaucoup plus systématique, à l’occasion d’évènements symbolique de la vie comme notamment le dépistage prénatal des hommes aura un impact beaucoup plus fort de lutte contre l’épidémie que la tentative de l’élargissement de la PrEP qui seront toujours un peu à la marge.
population très ciblée population HSH et on rentre dans un rapport un peu différentiel par rapport aux HSH parisiens avec lesquels j’avais travaillé auparavant. Sur notre territoire ce sont des HSH qui sont moins identitaires, qui ont plus souvent jamais eu recours à la sérologie VIH, qui fréquentent moins de lieux de convivialité gay, parce qu’en Seine-Saint-Denis n’y en a peu ou pas. Ils ont une connaissance un peu différée dans le temps des stratégies de prévention de la PrEP, une moins bonne connaissance de façon générale sur la santé sexuelle, les IST bactériennes. La deuxième population qu’on voit beaucoup, en suivi de VIH, sont les personnes originaires d’Afrique Subsaharienne qui constituent l’essentielle de notre file active. Ces populations bénéficient peu ou pas du tout de la PrEP. Alors on essaye de leur faire bénéficier de tout ce qui est possible comme stratégie de prévention. Je pense que, sur ces populations-là, le Test and Treat ; à savoir le dépistage, beaucoup plus systématique, à l’occasion d’évènements symbolique de la vie comme notamment le dépistage prénatal des hommes aura un impact beaucoup plus fort de lutte contre l’épidémie que la tentative de l’élargissement de la PrEP qui seront toujours un peu à la marge. Les grandes avancées en 2002, lorsque dans mon pays le président de la république a annoncé la gratuité des antirétroviraux. Là ça m’a beaucoup aidé et je me suis sentie bien parce que je me suis dit qu’on est proche de la victoire. C’était un grand jour, pour nous qui avons connu les années sombres ; c’est à dire les années où on nous dépistait et qu’il n’y avait pas de traitement. On prenait notre mal en patience et le jour où ils ont déclarés la gratuité des ARV et bien on a fait carrément une fête à l’association. L’autre date, c’est quand on m’a décoré la légion d’honneur française pour le travail que j’ai fait en 2014. J’ai compris que les gens me suivaient de prêt parce que je ne savais pas que l’on remarquait un peu ce que je faisais ; c’est là que j’ai compris que les actions que je mène sont suivies. En fait, je menais mon travail et je m’en fous de la politique. Je fais mon plaidoyer et j’avance avec les gens derrière suivaient mes pas et voyaient où je voulais en venir, donc c’est une reconnaissance du travail mené. Puis le Burkina a reconnu aussi le travail et m’a donné l’ordre du mérite. Ce sont des dates qui m’ont marqué positivement. Il y a des dates qui m’ont marqué négativement aussi, quand on a perdu des grands amis du VIH, des combattants de chemin, des acteurs de la lutte qui sont tombés sur le poids du sida et là ce sont des périodes où c’était dur. Aujourd’hui, nous, on vit. On n’est pas plus intelligent, on n’est pas plus joli, on n’est pas plus beau, on n’est pas plus fort c’est nous qui vivons … c’est une injustice. C’est pour eux qu’on est toujours engagé parce que si on baisse les bras, c’est comme si on les abandonnait.
Les grandes avancées en 2002, lorsque dans mon pays le président de la république a annoncé la gratuité des antirétroviraux. Là ça m’a beaucoup aidé et je me suis sentie bien parce que je me suis dit qu’on est proche de la victoire. C’était un grand jour, pour nous qui avons connu les années sombres ; c’est à dire les années où on nous dépistait et qu’il n’y avait pas de traitement. On prenait notre mal en patience et le jour où ils ont déclarés la gratuité des ARV et bien on a fait carrément une fête à l’association. L’autre date, c’est quand on m’a décoré la légion d’honneur française pour le travail que j’ai fait en 2014. J’ai compris que les gens me suivaient de prêt parce que je ne savais pas que l’on remarquait un peu ce que je faisais ; c’est là que j’ai compris que les actions que je mène sont suivies. En fait, je menais mon travail et je m’en fous de la politique. Je fais mon plaidoyer et j’avance avec les gens derrière suivaient mes pas et voyaient où je voulais en venir, donc c’est une reconnaissance du travail mené. Puis le Burkina a reconnu aussi le travail et m’a donné l’ordre du mérite. Ce sont des dates qui m’ont marqué positivement. Il y a des dates qui m’ont marqué négativement aussi, quand on a perdu des grands amis du VIH, des combattants de chemin, des acteurs de la lutte qui sont tombés sur le poids du sida et là ce sont des périodes où c’était dur. Aujourd’hui, nous, on vit. On n’est pas plus intelligent, on n’est pas plus joli, on n’est pas plus beau, on n’est pas plus fort c’est nous qui vivons … c’est une injustice. C’est pour eux qu’on est toujours engagé parce que si on baisse les bras, c’est comme si on les abandonnait. La première mission de Solidarité Sida est d’organiser des évènements pour récolter des fonds. On a fait le choix d’organiser des évènements donc de faire du don direct par exemple. On organise par exemple le festival Solidays, qui est l’évènement le plus connu. On organise aussi un gala. Notre idée c’est vraiment d’organiser un évènement pour récolter des fonds qui soient reversés ensuite en France et à l’international à des associations d’aide aux malades, de soutien aux personnes vulnérables ou à des projets de prévention. A côté de cela, on a aussi une mission de prévention en France. Le pôle prévention mène des actions en Ile de France et auprès des lycéens dans la France. On intervient autant auprès de la population générale type foyers jeunes travailleurs qu’auprès des populations clés notamment dans le quartier gay du marais et dans le milieu festif auprès des usagers de drogue ou encore en détention.
La première mission de Solidarité Sida est d’organiser des évènements pour récolter des fonds. On a fait le choix d’organiser des évènements donc de faire du don direct par exemple. On organise par exemple le festival Solidays, qui est l’évènement le plus connu. On organise aussi un gala. Notre idée c’est vraiment d’organiser un évènement pour récolter des fonds qui soient reversés ensuite en France et à l’international à des associations d’aide aux malades, de soutien aux personnes vulnérables ou à des projets de prévention. A côté de cela, on a aussi une mission de prévention en France. Le pôle prévention mène des actions en Ile de France et auprès des lycéens dans la France. On intervient autant auprès de la population générale type foyers jeunes travailleurs qu’auprès des populations clés notamment dans le quartier gay du marais et dans le milieu festif auprès des usagers de drogue ou encore en détention. Personnellement, je suis africain. C’est l’arrivée des traitements qui ont vraiment changé notre vie ; en fait la vie des malades, la vie des médecins et la vie des militants. Moi, j’ai commencé dans le sida en tant que militant. C’est vrai que je faisais des études de médecine. Je suis devenu médecin et quand je finissais ma médecine ; à savoir en 96 ; il n’y avait pas de médicaments accessibles pour les personnes qui en avaient besoin. Les premières molécules sont réellement arrivées en 97- 98. Nous, quand on découvre le VIH, on a 20/ 21 ans et à cette époque le sida était égal à mort car il n’y avait pas de traitement. L’arrivée du traitement a été, pour moi, un chamboulement complet mais surtout l’accessibilité à la plus grande population, avec l’accès gratuit en Côte d’Ivoire en 2007-2008. Cela fait 10 ans que l’accès est vraiment universel en tout cas en Côte d’Ivoire. Sinon, les autres dates, sont les avancées scientifiques lorsque les premières preuves d’efficacité du traitement ont montré qu’une personne infectée et sous traitement n’infecte plus son partenaire, cela a été un grand chamboulement. Maintenant, dans les nouvelles approches, comme la prévention ; à savoir la PrEP, je suis actuellement responsable d’un projet de la faisabilité de la PrEP chez les travailleurs du sexe en Côte d’Ivoire.
Personnellement, je suis africain. C’est l’arrivée des traitements qui ont vraiment changé notre vie ; en fait la vie des malades, la vie des médecins et la vie des militants. Moi, j’ai commencé dans le sida en tant que militant. C’est vrai que je faisais des études de médecine. Je suis devenu médecin et quand je finissais ma médecine ; à savoir en 96 ; il n’y avait pas de médicaments accessibles pour les personnes qui en avaient besoin. Les premières molécules sont réellement arrivées en 97- 98. Nous, quand on découvre le VIH, on a 20/ 21 ans et à cette époque le sida était égal à mort car il n’y avait pas de traitement. L’arrivée du traitement a été, pour moi, un chamboulement complet mais surtout l’accessibilité à la plus grande population, avec l’accès gratuit en Côte d’Ivoire en 2007-2008. Cela fait 10 ans que l’accès est vraiment universel en tout cas en Côte d’Ivoire. Sinon, les autres dates, sont les avancées scientifiques lorsque les premières preuves d’efficacité du traitement ont montré qu’une personne infectée et sous traitement n’infecte plus son partenaire, cela a été un grand chamboulement. Maintenant, dans les nouvelles approches, comme la prévention ; à savoir la PrEP, je suis actuellement responsable d’un projet de la faisabilité de la PrEP chez les travailleurs du sexe en Côte d’Ivoire. Trois dates clés… uniquement trois. Certainement 1983, l’identification et la publication des virus. L’interaction entre association et recherche non pas parce que c’est une équipe française qui l’a fait mais sans l’identification de la cause, on n’aurait certainement pas progressé assez vite dans la première phase de l’épidémie. Même si les deux années qui ont précédées, on a pratiquement tout compris de l’épidémie et de la transmission de ce virus ; alors qu’on en avait pas la cause mais si on n’avait pas identifié la cause c’est sûr que ça aurait été absolument impossible. Certainement le deuxième moment, c’est l’émergence des traitements dans le monde ; c’est-à-dire le passage du traitement réservé aux pays industrialisés aux traitements dans le monde entier. Soit en 2002, la conférence de Barcelone. En effet, c’était un peu la fin d’un cycle : Jacques CHIRAC, en 1999 va annoncer que les traitements étaient aux nord et les malades au sud ; puis, en 2000, Nelson MANDELA a dit à Durban que c’était inacceptable. En 2002, Nelson MANDELA monte à la tribune avec Bill CLINTON (qui n’était plus président à l’époque) pour dire qu’il fallait passer à l’acte. Ceci a permis, à partir de là, la bascule dans l’air des traitements dans le monde entier. Peut-être que la troisième date que je retiendrais, c’est probablement 2012-2013 ; à savoir la démonstration absolue que le traitement c’est la prévention. Pour le dire autrement, l’essai HPTN 052 qui démontrent définitivement qu’on peut réduire 96 % de la transmission par le traitement. C’est 3 dates prises parmi d’autres…
Trois dates clés… uniquement trois. Certainement 1983, l’identification et la publication des virus. L’interaction entre association et recherche non pas parce que c’est une équipe française qui l’a fait mais sans l’identification de la cause, on n’aurait certainement pas progressé assez vite dans la première phase de l’épidémie. Même si les deux années qui ont précédées, on a pratiquement tout compris de l’épidémie et de la transmission de ce virus ; alors qu’on en avait pas la cause mais si on n’avait pas identifié la cause c’est sûr que ça aurait été absolument impossible. Certainement le deuxième moment, c’est l’émergence des traitements dans le monde ; c’est-à-dire le passage du traitement réservé aux pays industrialisés aux traitements dans le monde entier. Soit en 2002, la conférence de Barcelone. En effet, c’était un peu la fin d’un cycle : Jacques CHIRAC, en 1999 va annoncer que les traitements étaient aux nord et les malades au sud ; puis, en 2000, Nelson MANDELA a dit à Durban que c’était inacceptable. En 2002, Nelson MANDELA monte à la tribune avec Bill CLINTON (qui n’était plus président à l’époque) pour dire qu’il fallait passer à l’acte. Ceci a permis, à partir de là, la bascule dans l’air des traitements dans le monde entier. Peut-être que la troisième date que je retiendrais, c’est probablement 2012-2013 ; à savoir la démonstration absolue que le traitement c’est la prévention. Pour le dire autrement, l’essai HPTN 052 qui démontrent définitivement qu’on peut réduire 96 % de la transmission par le traitement. C’est 3 dates prises parmi d’autres… J’ai plusieurs casquettes, une hospitalière, je suis médecin à l’hôpital de jour adultes de Cayenne, je suis également en charge des personnes infectées par le VIH au centre pénitenciers, j’ai des activités associatives, je suis présidente du réseau ville hôpital qui s’appelle le réseau kikiwi et enfin plus récemment depuis fin 2013, je coordonne les CeGIDD pour la Croix Rouge comprenant également un centre de vaccination et lutte antituberculeuse pour les centres de prévention santé de la Croix Rouge de la Guyane donc sur tout le littoral guyanais c’est-à-dire Cayenne, Saint Laurent.
J’ai plusieurs casquettes, une hospitalière, je suis médecin à l’hôpital de jour adultes de Cayenne, je suis également en charge des personnes infectées par le VIH au centre pénitenciers, j’ai des activités associatives, je suis présidente du réseau ville hôpital qui s’appelle le réseau kikiwi et enfin plus récemment depuis fin 2013, je coordonne les CeGIDD pour la Croix Rouge comprenant également un centre de vaccination et lutte antituberculeuse pour les centres de prévention santé de la Croix Rouge de la Guyane donc sur tout le littoral guyanais c’est-à-dire Cayenne, Saint Laurent.